#20 - Replay de fantaisie finale
Ou Cloud in the Sky. Ou Jean-Cloud Vandale. Ou un Cloud dans la chaussure. Non c'est un caillou. Donc ça marche pas. Mais vous voyez le délire.
Vous vous souvenez quand la mode de la nostalgie c’était les années 80 ? C’est fini cette époque: Stranger Things est terminé presque terminé, on sort peu à peu des licences des années 80, même s’il y a encore quelques restes comme un énième SOS Fantômes qui veut surfer sur l’iconisation de ses personnages pour les remettre sur le devant de la scène. Tout ça est un peu éclipsé par la mode des références métas, des clins d’œils et des multivers qui permettent de s’adonner à cœur joie à faire sortir des acteurs.rices de leur retraite bien mérité.
Mais les années 90 commencent à bien s’installer dans la case nostalgie, ressortant l’ère des cassettes et des dessins animés que l’on regardait avec son petit bol de céréales le samedi matin. Comme toute mode, certains arrivent à s’émanciper pour proposer quelque chose de réellement intéressant. C’est le cas de X-Men ‘97 qui avait tout de la mauvaise idée sur le papier. On fait revenir les souvenirs des petiots du dessin animé X-Men de 92 en conservant les designs des personnages de l’époque (en modifiant quand même certains noms, parce que Serval ça le fait plus trop) et rebelote. Il faut dire que la série, dans l’esprit de beaucoup de trentenaires bien installés, résonne beaucoup, notamment ce générique qui garde une patate indescriptible. Mais si la promotion de Marvel sur cette nouvelle série lorgne complètement dans le désirata nostalgique un peu gonflant (il suffit de voir les affiches misant tout sur le côté générationnel), il se trouve que l’équipe artistique derrière a une certaine ambition pour continuer ce que la série originale avait entrepris: adapter et respecter l’esprit des comics originaux.
Car on l’oublie souvent, mais les comics Marvel possèdent de sacrées bonnes histoires en papier, que les films oublient bien trop souvent quand il s’agit d’adapter certains arcs narratifs (n’est-ce pas Thor: Love and Thunder). Les X-Men font partie des histoires de comics qui ont su marquer leur époque de façon continue, multipliant les personnages et les événements majeurs qui ont jonché l’histoire mutante de Marvel. Un vrai microcosme qui a plus ou moins souvent vécu en vase clos par rapport aux reste des héros. La série originale l’avait bien compris et se permettait d’adapter des moments forts. Et la nouvelle série actuelle ne fait que perpétuer cette tradition. Elle n’hésite pas à reprendre l’histoire là où on s’était arrêté (Xavier est considéré comme mort, Magneto reprend la direction de l’école) et continue d’adapter les arcs importants. Et comme les X-Men ont toujours développer des thématiques fortes sur la différence et comment réagir face aux persécutions, elles sont toujours d’actualité et ne lésinent pas pour jouer sur des moments tragiques sans concession. Evidemment, le style graphique et l’animation subissent parfois le budget d’une série, mais quel plaisir de retrouver ces personnages trop souvent malmenés.
Mais les modes dans le domaine culturel touchent également les jeux vidéos. On pourrait même parler de recettes tant on voit certains concepts repris de gros succès, où les studios et éditeurs sont persuadés qu’en pariant sur un genre qui cartonne, ça finira par marcher. Combien de Vampire Survivors-like a-t-on vu débarquer ces deux dernières années ? La scène indépendante, qui continuait à se chercher il y a peu, est en train de prendre le pli des gros éditeurs en cherchant à copier la recette miracle.
Le récent showcase Tripe-i Initiative a montré à quel point la scène indépendante rentre dans les clous. Cette conférence en ligne, centré sur les gros jeux indépendants, étaient l’occasion de mettre en lumière les titres à venir. Mais pas des petits indépendants: on parle ici des gros poissons, ceux qui ont déjà montré ce dont ils étaient capable, voire même parfois des chevaux de Troie comme un jeu estampillé Prince of Persia (chez Ubisoft, donc) mais géré par Motion Twin, les petits gars derrière une partie de Dead Cells. La petite caution indépendante du gros éditeur donc. Pas question de parler de la qualité du jeu qui sera peut-être très bien, mais était-il à la bonne place ?
Et pour le reste, les recettes sont bien en place. La mode du rogue-like a envahi n’importe quel style de jeu, allant même jusqu’à toucher les plus gros (God of War Ragnarök, Last of Us 2) via des ajouts supplémentaires. Vampire Survivors commence à titiller les plus gros en s’associant avec la licence Contra, tandis que Death must Die tente de se faire une place dans son giron. Les simulateurs de vie/city-builder ont la côte (Norland, Undermine 2), les dungeon crawler également (Wizard of Legend 2): que des titres avec de belles promesses mais manquant cruellement d’une certaine inventivité. Les Steam Neo Fest sont de meilleurs occasions pour dénicher quelques pépites, voire même de les tester.
[#série] - Ripley
A New York dans les années 60, Tom Ripley est un homme qui vit d’arnaques à l’assurance et parvient à maintenir un niveau de vie correcte mais loin de ses ambitions. Un détective privé le contacte alors pour lui signaler qu’un riche armateur, Herbet Greenleaf, souhaite le rencontrer. Il a appris que Ripley était un ancien ami d’université de son fils, Richard Greenleaf, vivant actuellement en Italie et profitant du cadre pour apprendre la peinture. Il charge Ripley d’aller à sa rencontre pour convaincre Richard de rentrer aux Etats-Unis et reprendre l’affaire familiale. Ripley se saisit de l’opportunité pour utiliser ses talents d’escroc à ses fins, mais ce ne sera que le début d’une histoire de faux-semblants et de fraudes.
Si le pitch vous dit quelque chose, c’est normal. Ripley est une nouvelle adaptation du roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley et il a déjà eu droit à plusieurs adaptations, dont l’une des plus connues se nomme Le Talentueux Mr Ripley, un film de 1999 avec Matt Damon et Jude Law. La série de Netflix reprend peu ou prou la même trame narrative mais avec une vraie différence de ton, privilégiant le genre du film noir comme influence tout en remettant le charme des côtes italiennes comme un contexte enchanteur mais dangereux. La série est l’œuvre de Steven Zaillian, peu connu mais pourtant déjà le chef d’orchestre de la mini-série The Night Of, superbe mini-série HBO avec Riz Ahmed et John Turturro.
Pour Ripley, Zaillian a fait le choix d’utiliser le noir et blanc, ce qui donne à la série une vraie tenue visuelle, rappelant les films noirs américains des années 40/50. Les superbes décors de la côte italienne des années 60 mélangés avec les compositions sublimes et travaillées de la série font de Ripley une œuvre déjà magnifique à regarder. La réalisation sait prendre le temps d’installer les moments de tension, étirant la temporalité pour mieux saisir les dangers d’une supercherie qui peut être découverte à tout moment. On pourra tiquer sur quelques détails un peu tirés par les cheveux afin de maintenir le suspense jusqu’au bout mais le plaisir est là à chaque instant et c’est un vrai bonheur à suivre.
Mais surtout, Ripley est incarné par Andrew Scott, un acteur que vous avez sans doute déjà vu dans bon nombre de séries anglaises, notamment en Moriarty dans la récente série Sherlock ou encore en tant que célèbre “hot priest” de la série Fleabag. L’acteur joue à la perfection cet escroc au regard perçant, qui projette une relative sympathie mêlé d’une méfiance certaine. Il ne dégage jamais une assurance de tous les instants. Même si le personnage se débrouille de mieux en mieux, l’acteur arrive à insuffler ce qu’il faut de fragilité pour donner l’impression que tout peut s’effondrer à chaque seconde. On a envie de le suivre dans ses aventures alors qu’il devrait se faire avoir un nombre incalculable de fois. Et c’est ce côté bancal du personnage qui donne une certaine saveur à l’histoire. On a envie de voir la prochaine étape, de voir les différents environnements traversés et d’observer comment les autres personnages continuent à être aveuglés par cet homme. Une vraie petite pépite non sans défauts mais jamais dénué de charme.
Ripley / Créée par Steven Zaillian / Avec Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Eliot Sumner / Mini-série (8 épisodes) / Dispo sur Netflix
[#jeu vidéo] - Final Fantasy VII Rebirth
En 2020 sortait Final Fantasy VII Remake. Projet pharaonique de la part de Square-Enix, ce remake était le premier volet d’une trilogie pour “refaire” Final Fantasy VII. Un épisode à part dans le cœur de nombreux fans de RPG japonais, qui a été pour beaucoup le premier à débarquer en 1997 sur la première Playstation (et aussi un des premiers à être traduits dans un français légèrement approximatif). Une œuvre phare dont Remake avait su retranscrire toute la quintessence du jeu original, parvenant à la fois à donner l’ambition nécessaire pour enfin représenter l’univers du jeu, notamment la cité de Midgar, tout en transcendant le système de combat sans jamais trahir l’esprit original. Un vrai tour de force, trop long pour certains (30h de jeu sur Remake d’une portion du jeu qui représentait 6-7h dans le jeu original) mais qui avait su convaincre, notamment en créant la surprise de ne pas être qu’un simple remake: le scénario diverge sur plusieurs points, et jamais innocemment, dont les têtes pensantes sont en grande partie celles du jeu de 7 (notamment le producteur Yoshinori Kitase et le réalisateur Tetsuya Nomura).
Final Fantasy VII Rebirth reprend là où le joueur avait été laissé dans Final Fantasy VII Remake: la petite équipe composée de Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII part de Midgar à la poursuite de Sephiroth afin de l’empêcher de détruire le monde. Un défi de taille pour Square-Enix, car dans le jeu original, c’était le moment où le joueur était lâché dans un monde ouvert, où on pouvait se déplacer sur une carte du monde (limitée par les déplacements à pied) afin de rallier les différents points d’intérêts. Une ambition folle, que Square-Enix relève avec succès, et plus encore, car c’est la grande force de ce Rebirth: le sentiment de voyage et d’aventure est magnifiquement retranscrit avec une envergure assez dingue. On évolue de zones en zones, avec régulièrement des niveaux/donjons faisant office de passages obligés pour accéder à la zone suivante, souvent liés par des villes connues du jeu original. Mais c’est au fil de l’aventure que le titre révèle à quel point tout fait sens dans la construction de l’univers, de la même façon que le faisait le jeu original mais avec une grille de lecture bien plus grande.
Final Fantasy VII Rebirth continue son travail de remake avec un soin tout particulier pour jouer sur les souvenirs du joueur. Les limitations de la PsOne et la technique 3D de l’époque étaient là pour faire le pont entre l’histoire dévoilée et l’imagination du joueur et lui faire croire à cet univers gigantesque. Une technique vieillissante qui marche bien moins si on se lance dans l’aventure originale aujourd’hui. Pour la première fois, l’univers de Final Fantasy VII Rebirth est représenté avec les moyens adéquats pour traduire le ressenti que l’on avait en tant que joueur à l’époque. Cela donne un sentiment vertigineux: celui de se projeter dans un univers complètement familier mais avec une redécouverte totale et un plaisir incroyable, comme si tout ce que le jeu original suggérait était enfin là, sous nos yeux, et accessible. Les moyens pour y arriver ont l’air énorme, mais rarement le sentiment de voyager dans un univers aussi unique a été aussi palpable, surtout dans un monde qui touche des thématiques toujours vivaces. On y voit les stigmates de la multinationale Shinra à chaque traversée, ses réacteurs ponctionnant toujours un peu plus l’énergie d’une planète qui ne cesse de tirer la sonnette d’alarme. Plus encore aujourd’hui, la dimension écologique du jeu original est au centre des enjeux.
Square-Enix en profite même pour accentuer les relations entre les personnages, renforçant l’écriture pour leur donner bien plus de profondeur qu’auparavant. Chacun a son moment, son affinité avec l’équipe qui se développe, et des personnages comme Red XIII ou Cait Sith, souvent relégués au second plan, se retrouve ici bien mieux écrits et attachants. L’histoire est longue et passionnante (70-80h de jeu pour en voir le bout), revisitant les séquences cultes du jeu de 1997 (et il y en a), ne se privant jamais de les revisiter, souvent en mieux, saisissant l’importance dans la mémoire de joueur pour mieux les appréhender. Le contenu du jeu est gargantuesque, avec un monde ouvert rempli d’activités, pas toujours intéressant, et on trouve une foule de mini-jeux dans tous les sens, comprenant notamment un mini-jeu de cartes très bien pensé (le Queen’s Blood) ou encore des courses de Chocobos avec pas moins d’une vingtaine de circuits. Tous ne sont pas de qualité équivalente et Square-Enix a eu la main un peu lourde dessus, mais il y a de quoi faire.
Et la technique n’est pas mise de côté, alors que le nombre d’endroits visités est faramineux. Le moindre village que l’on traverse en deux écrans dans l’original est ici complètement repensé, avec de nombreux bâtiments à voir et bien plus de choses à y faire. Tout devient plus tangible, crédible, avec un soin vraiment bluffant sur certains panoramas qui font plaisir à voir. Tout ça accompagné d’une bande-son assez incroyable, reprenant les thèmes bien connus du jeu avec un talent certain et restant éternellement dans la tête. Le boulot sur les arrangements des musiques est minutieux, réussissant quasiment à chaque fois à saisir l’essence de la mélodie pour mieux la retranscrire, et proposant même certains thèmes inédits vraiment réussies. Côté bande-son, c’est un sans faute.
Mais Final Fantasy ne serait pas un Final Fantasy sans son système de combat. Reprenant celui de Remake, les combats sont toujours en temps réel, laissant le joueur contrôler le personnage qu’il désire parmi les trois de l’équipe qu’il a choisi, avec la possibilité de mettre le jeu en quasi pause afin de choisir une action a réaliser (compétences, magie, utilisation d’objets). Une action est uniquement possible en attaquant l’ennemi avec l’attaque de base ou en se protégeant afin de remplir une jauge, ce qui force le joueur à switcher régulièrement de personnage pour accélérer l’accès à ces actions. Rebirth introduit bien plus de coopération entre les personnages: utiliser des actions remplis des slots qui, s’ils sont assez nombreux, permettent de réaliser de puissantes attaques synchronisés. Les personnages peuvent même annuler les dégâts en se protégeant au bon moment. Et tout ça marche évidemment avec le système de materias, des sphères magiques que l’on attribue sur les armes et l’équipement pour assigner à chaque personnage des magies, des compétences actives ou passives, que l’on peut associer à d’autres pour les booster.
Un système toujours aussi incroyablement riche, permettant de moduler ses personnages à l’envie, alors même qu’ils ont déjà des prédispositions: Tifa combat au corps à corps, gonflant bien plus vite la barre de Fragilité de l’ennemi pour le sonner et accentuer les dégâts, alors que Barret reste à distance avec son bras fusil, tandis que Red XIII peut accumuler une jaune de rage s’il réussit à contrer avec le bon timing. Il faut ajouter à ça les invocations qui peuvent aider en cours de combat et les Limites, des attaques puissantes que l’on peut déclencher au bout d’un certain temps, et vous aurez probablement l’un des meilleurs système de combat en J-RPG, réussissant à allier la tactique des épisodes originaux avec le beath’em all en temps réel. Une réussite incontestable.
Au terme de son aventure, Final Fantasy VII Rebirth reste un jeu peut-être trop gourmand pour son propre bien, les équipes de Square-Enix ayant rempli à raz bord un jeu qui possède une aventure déjà sacrément satisfaisante. L’histoire reste en suspens avant le troisième épisode de ce remake qui se chargera de conclure l’histoire, et là encore, même ceux qui connaissent les enjeux et le scénario ne sont pas au bout de leurs surprises. Certains choix scénaristiques sont parfois un peu décevants, mais l’aventure que l’on traverse est telle qu’on s’embarque dans l’histoire sans difficultés, porté par la réussite de pratiquement tous les aspects du jeu. Il ne reste plus qu’à attendre dans trois ans pour voir le fin mot de cette histoire.
Final Fantasy VII Rebirth / Développé par Square-Enix / Sortie le 29 février 2024 / Disponible sur Playstation 5 / Prix: 70 euros
[#film] - Nous, les Leroy
Sandrine Leroy (Charlotte Gainsbourg) n’en peut plus de sa situation familiale, entre un mari quasi absent et des enfants qui prennent leur indépendance. Elle l’annonce à son mari Christophe (José Garcia) qui n’accepte pas cette décision. Pour tenter d’arranger les choses, il embarque toute sa famille dans un long road trip de trois jours pour revenir aux endroits qui ont marqué la famille Leroy. Si au bout de ses trois jours Sandrine reste sur son envie de divorcer, il acceptera alors sa décision.
Quel parcours depuis les vidéos Youtube. FloBer, alias Florent Bernard, a fait ses armes dans l’écriture et la réalisation sur la plate-forme Golden Moustache et crée le groupe Suricate, avant de partir en tant qu’auteur sur des séries comme Bloqués avec Orelsan et Gringe, la série Youtube Groom ou encore la série La Flamme/Le Flambeau. Il est aussi connu pour animer le podcast audio Floodcast avec Adrien Ménielle, bref: une vraie personnalité dans le paysage du contenu Internet, qui a su se renouveler et se rapprocher peu à peu du cinéma, notamment récemment en co-écrivant l’excellent film Vermines. Pour sa première réalisation, il ne fait pas les choses à moitié en embarquant avec lui Charlotte Gainsbourg et José Garcia, mais également tous ses potes.
Car c’est évidemment quelque chose qu’on remarque pendant le film: la présence de petits rôles que FloBer distribue à toute sa clique qui le suit depuis dix ans. C’est un gros risque, dans le sens où ça peut donner l’impression que le film se suit comme une succession de sketches Golden Moustache, mais la force de Nous, les Leroy, c’est de ne jamais perdre de vue son sujet principal. On aura beau rire devant les personnages géniaux d’Adrien Ménielle ou Sébastien Chassagne, le cœur du film reste le voyage familial de ces quatre personnages qui se retrouvent embarqués contre leur gré. La bande-annonce peut laisser penser à une comédie française typique, mais si le scénario nous embarque dans des séquences souvent très drôles dans sa première partie, qui jouent énormément sur le décalage des dialogues, le film embarque peu à peu sur un ton plus émotionnel.
Car Nous, les Leroy, c’est surtout un film sur la déconstruction d’une famille et sa possible reconstruction. Il y a une certaine nostalgie dans le film, dans les paysages traversés, dans ces zones commerciales en dehors des grandes villes qui rappellent des souvenirs. Chaque personnage s’éloigne peu à peu des enjeux principaux pour se renfermer sur les siens, plus intimes, plus personnelles, où ils ne parviennent pas à trouver du soutien dans une famille censé les aider à traverser leurs problèmes. Nous, les Leroy quitte alors le tout-comique pour chercher l’émotion et la sensibilité, avec une famille qui n’arrive plus à communiquer. Chacun aura son moment, son background, tout en gardant un équilibre comique qui touche juste sans être lourdingue ou casser le versant émotionnel. Les punchlines fusent toujours, l’écriture est vraiment au top, et on sent FloBer parfaitement à l’aise dans ce numéro d’équilibriste. Pour un premier film, il va déjà plus loin que le tout-venant de la comédie française, et c’est sacrément rafraîchissant.
Nous, les Leroy / Réalisé par Florent Bernard / Avec Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé /Sortie le 10 avril 2024
[#bande dessinée] - La route
Issu du célèbre roman de Cormac McCarthy, La Route de Manu Larcenet adapte l’œuvre originale à travers une bande dessinée au format large. Le contexte est le même: on y suit un père et son fils dans un monde complètement ravagé, poussant un chariot rempli de leurs affaires et tentant de survivre tant bien que mal. On les voit sur la route en direction du Sud, s’arrêtant prudemment dans des bicoques mal arrangés à la recherche de nourriture ou s’abritant du froid pour tenir le coup jusqu’à des températures plus clémentes.
On connaît Manu Larcenet pour de multiples œuvres très différentes les unes des autres. C’est un des rares auteurs qui parvient à modifier et adapter son style par rapport à ce qu’il raconte, sans jamais sacrifier ce qui en fait sa caractéristique. Il va pouvoir autant adapter son trait sur Le retour à la Terre et jouer sur des strips humoristiques que reprendre certains designs de personnages mais complètement changer sa narration sur Le Combat Ordinaire. Rien à voir non plus sur Blast, une de ses œuvres les plus tranchés et radicales, où l’abstrait vient amener des choses sensorielles. Pour La Route, Larcenet reprend son style très graphique et fouillé qu’il a amorcé sur Le Rapport de Brodeck, en jouant encore plus sur les espaces de son environnement pour mieux placer ses personnages.
Continuellement ancré dans une poussière noire qui recouvre peu à peu les paysages désolées, La Route joue énormément sur l’étirement temporel à travers des petites cases où l’on discerner ses deux silhouettes marchant dans des ruines poussièreuses et contrastées. On y suit leur longue traversée, ponctuellement marquée par des événements de tension soudaine lorsque le danger arrive sans prévenir, servant également à montrer l’implacable absence d’humanité. Le père et le fils deviennent “les gentils”, ceux qui refusent de manger les autres et gardent une lueur d’espoir alors même que leur destination reste complètement flou. Inutile de dire que le fun n’est pas au rendez-vous.
Mais La Route est une merveille de noirceur, comme Larcenet sait si bien les faire. On sent la saleté dans toutes les cases, dans tous les détails graphiques des personnages, comme pour marquer une vie de souffrance. Les dessins sont remarquablement conçus, avec un sens du découpage qui ferait presque regretter les quelques dialogues qui parsèment le livre. Ils restent essentiels pour comprendre la relation entre le père et le fils, arrivent même à émouvoir grâce à un soin particulier, et emmènent le lecteur là où il faut. La version noir et blanc de la bande dessinée sublime encore plus l’œuvre, qui de toute façon n’avait pas beaucoup de couleur de base. Une vraie perle noire, et encore un immanquable chez Larcenet.
La Route / Manu Larcenet / Editeur: Dargaud / One-shot
Les films gratos du mois
Ce mois-ci: encore une fois un très bon cru, avec du côté France.tv deux films d’Oliver Stone pour découvrir ce réalisateur américain engagé, un classique de Kurosawa, un Dupieux récent et un film de Baumbach qui fait découvrir Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie, en tant qu’actrice. Côté Arte, la chaîne ne fait pas les choses à moitié avec une grande rétrospective de Michael Haneke, réalisateur autrichien qui n’hésite pas à bousculer les codes, et va même chercher un casting français quand il en a besoin. Et ne passez pas à côté de l’excellent La loi de Téhéran du réalisateur iranien Saeed Roustayi.
Rashômon (Akira Kurosawa - 1952)
JFK (Oliver Stone - 1991)
Entre ciel et terre (Oliver Stone - 1993)
Le daim (Quentin Dupieux - 2019)
Frances Ha (Noah Baumbach - 2012)Funny Games (Michael Haneke - 1997)
Caché (Michael Haneke - 2005)
Le septième continent (Michael Haneke - 2011)
La Pianiste (Michael Haneke - 2001)
Le ruban blanc (Michael Haneke - 2009
Amour (Michael Haneke - 2012)La loi de Téhéran (Saeed Roustayi - 2019)
Gangs of New York (Martin Scorsese - 2002 - jusqu’au 5 mai)
Playlist du mois
Ce mois-ci, des directions variés, autant du côté de l’Afrique avec le jeu “indépendant-mais-ElectronicArts-quand-même” Zau et son style très marquée, des nappes électros planantes sur Planet Crafter mais aussi des sonorités montagnardes avec le city-builder Laysara.
Dans le cinéma, Civil War donne dans la mélodie sourde et froide tandis que The Peasants fait tout le contraire, avec des musiques entraînantes et des chants folkloriques. Et on n’oubliera pas l’excellente BO de Ripley.
Comme d’habitude, la playlist 2024 version Spotify s’étoffe tout au long de l’année, avec des morceaux des œuvres cités en rab pour les curieux.
» Accéder à la playlist Spotify de 2024
Playlist Youtube accessible en cliquant sur l’image
Misc
Gone Home, What remains of Edith Finch et plein d’autres: le walking simulator a accouché de quelques pépites mais s’est sacrément essouflé ces dernières années. Game Next Door analyse ça.
L’excellente chaîne The Movie Rabbit Hole (VO) analyse les CGI dans les gros films et notamment ce qui différencie un CGI visible ou invisible, et pourquoi certains réalisateur y arrivent mieux que d’autres
Chouette vidéo de 440 Hzqui analyse tout l’aspect musical du premier Bioshock, et pas uniquement sur ses musiques originales mais bien de tout ce qui habille le jeu
Nouveau Blow Up comme d’habitude passionnant, qui revient cette fois-ci sur la carrière de Kate Winslet
Sylvqin revient sur une personnalité importante de la scène pirate du jeu vidéo: Empress, et comment elle aura marqué son temps, tout en se mettant à dos beaucoup de gens
Pour le plaisir des yeux: un montage de la filmographie de Michael Mann, du Dernier des Mohicans à Ferrari
Analyse de la récente restauration de True Lies de James Cameron, qui sort enfin en HD mais avec un travail sur l’image lié à l’IA qui fait beaucoup de mal au film, tout en allant assez loin dans l’analyse technique (et c’est passionnant)
L’excellente chaîne Calmos revient avec une nouvelle vidéo Rigolo, qui parle cette fois-ci du film avec Coluche, Tchao Pantin, et de pourquoi les comiques passent souvent dans le registre dramatique







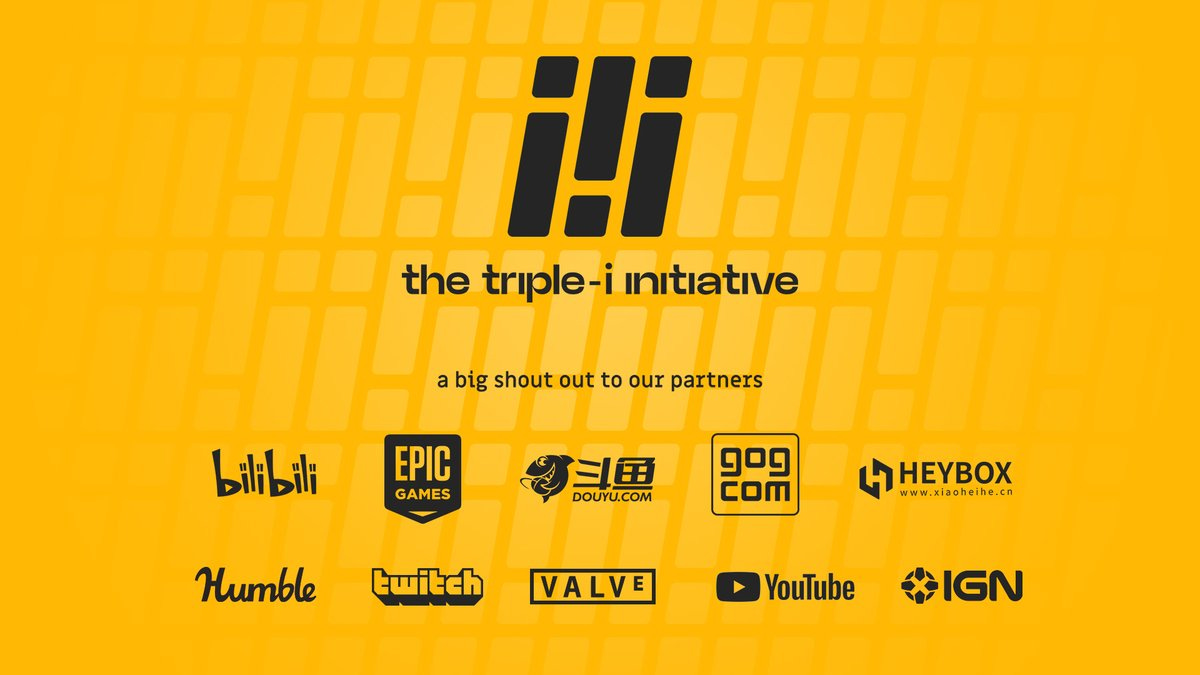



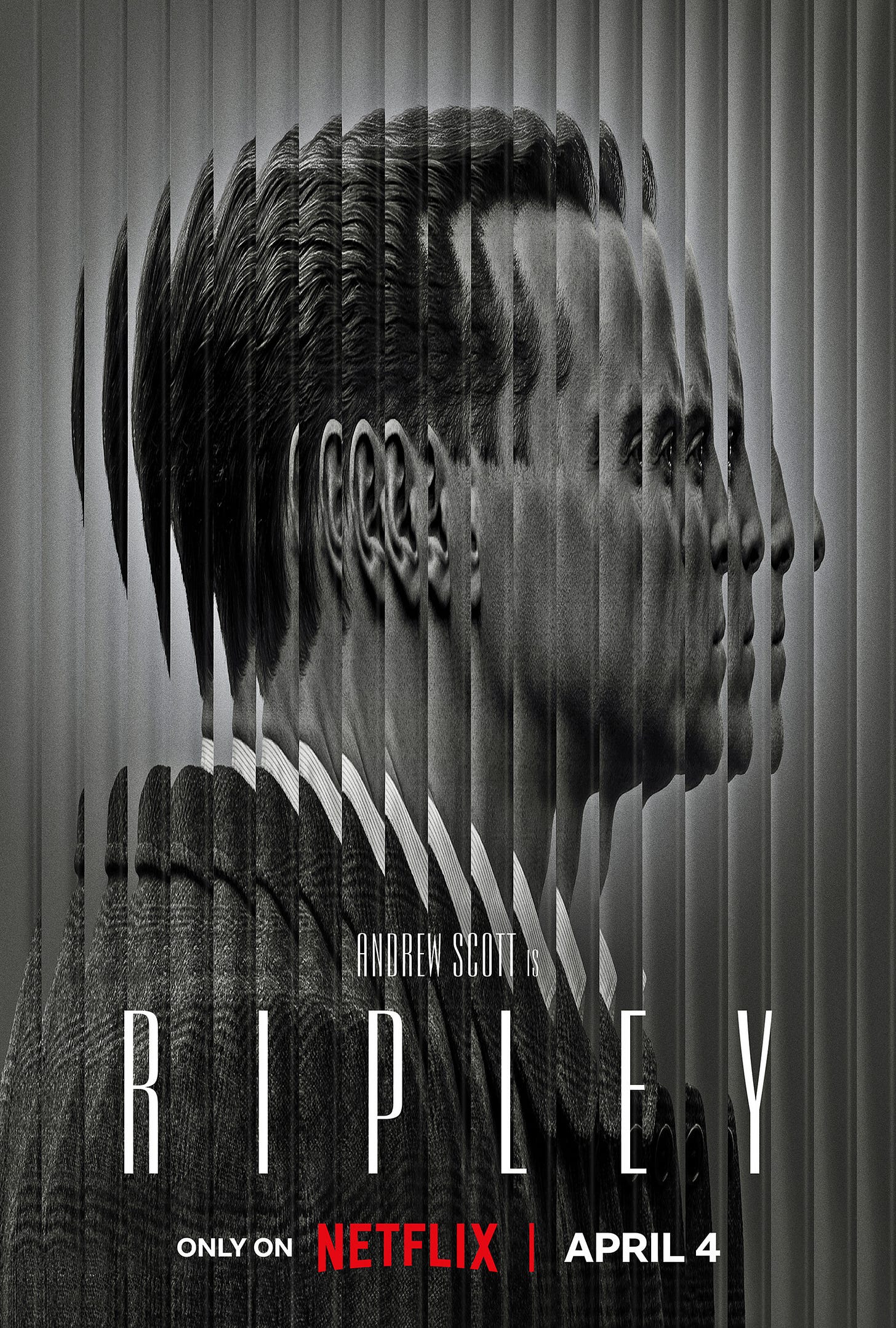















Je suis très fan de "un Cloud dans la chaussure" ;-)